BIOGRAPHIE DE
JEAN DE SACROBOSCO
La page qui suit s’appuie essentiellement sur l’enquête minutieuse menée par Olaf PEDERSON et publiée dans le Journal of the History of Astronomy en 1985 : In quest of Sacrobosco.
On ne sait pas grand chose de la vie de Sacrobosco (mais lisez tout de même la suite) ! Ni quel est la date et le lieu de sa naissance, ni la date de sa mort, le lieu de sa formation intellectuelle ou de quand date son arrivée précise à Paris. Le nom de Sacrobosco n’apparaît pas dans les registres ou documents historiques de son temps, du moins ceux qui nous sont parvenus.
Seules certitudes : il est d’origine anglo-saxonne (Irlandais, Ecossais ou Anglais ?), a enseigné à l’Université de Paris et est décédé dans cette ville. Les autres renseignements, provenant souvent des préfaces de ses travaux imprimés (lesquels furent imprimés très longtemps), ne sont pas toujours très fiables (même s’ils sont souvent recopiés… y compris dans les bibliographies disponibles sur Internet). Un document du XVIIe siècle affirme par exemple qu’il fut reçu à Paris le 5 juin 1221, mais rien n’est moins sûr.
Cependant, on peut esquisser certains traits du personnage et émettre des hypothèses assez plausibles…
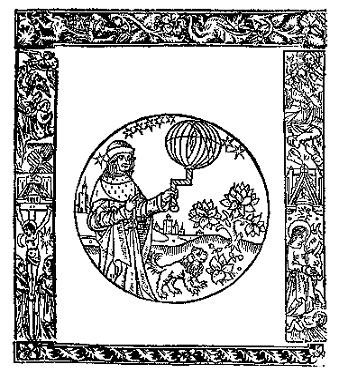
Le début : origines de Sacrobosco
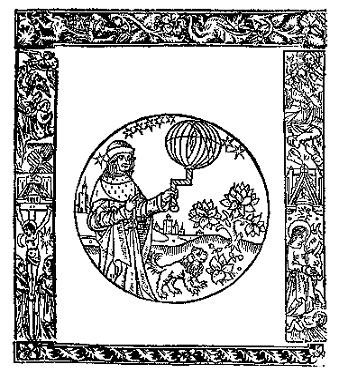
Si Sacrobosco est bien certainement la traduction de Holywood, où se situe ce dernier lieu ? Trois hypothèses s’affrontent : dans l’ordre chronologique, l’anglaise, l’irlandaise et l’écossaise. Inutile de dire que chacune de ces nations tient les autres hypothèses comme évidemment fausses ! En tant que français, et parisien d’adoption, j’ai bien envie de mettre tout le monde d’accord en revendiquant que Sacrobosco s’est surtout illustré à Paris. Mais André Thévet l’a fait avant moi (1516 ? – 1592) et dans une langue que je ne saurais imiter :
« Je ne veux point tenir plutost le party de l’un que de l’autre [à propos de l’origine de Sacrobosco], attendu qu’ils se débattent de la chappe à l’Evesque [expression d’époque…], d’autant qu’ils l’ont à la vérité en recommandation, pour avoir cet heur d’estre compatriots d’un si brave Astrologue [astronome] : mais les François doivent à beaucoup plus juste occasion s’en glorifier, ayans ésté honorés de son sçavoir, duquel particulièrement il les a voulu rendre depositaires. »
L’indice le plus sûr est donné en 1271 par Robertus Anglicus qui, dans un des premiers commentaires de « La Sphère », parle de « Johannes de Sacrobosco Anglicus ». Venant de la part d’un compatriote ayant vécu 30 ou 40 ans seulement après Sacrobosco, ce renseignement semble assez fiable. Sacrobosco serait donc anglais.
En 1540 apparaît l’hypothèse de John Leland : Sacrobosco serait l’équivalent latin du saxon Haligwalde correspondant au Halifax moderne (Yorkhire, Angleterre). Il y a cependant un problème : le saxon « fax » dans Halifax veut dire cheveu (« hair » en anglais et non « wood », bosco). Bref, Olaf Pedersen trouve cette construction très douteuse.
En 1577 surgit la piste irlandaise, due à Richard Stanyhurst, selon lequel Holywood est un lieu « connu » d’Irlande. Oui, mais quel « Holywood », il y a au moins deux candidats sérieux, l’un près de Belfast, l’autre proche de Dublin (pas de plaisanterie sur le Hollywood à Los Angeles, il ne compte pas). Plutôt douteux.
En 1627 arrive Thomas Dempter, avec une réponse écossaise. Sacrobosco ne serait pas le nom de son lieu de naissance mais celui de sa famille, déformation de « Halybush », qui fait de Sacrobosco un écossais. Un autre argument écossais met en avant le monastère d’Holywood au sud ouest de l’Ecosse qui était un site important au XIIe siècle, connu dans les documents latins de l’époque comme Sacro Bosco ou Sacri Nemoris.
Olaf Peterson s’étonne cependant qu’aucun auteur médiéval ne considère Sacrobosco comme écossais. Signalons que Peterson est, semble-t-il, danois (Université d’Aarhus) et donc a priori assez neutre dans cette affaire compliquée. Nous resterons sur l’idée que Sacrobosco était anglais mais qu’il aurait bien mérité d’être français.
La fin : tombe de Sacrobosco

On ne sait pas où est né Sacrobosco, mais on est sûr qu’il est mort à Paris et qu’il y fut enterré. En revanche, on ne connaît pas la date de cette mort : 1236 (c’est l’opinion de Pederson) ou 1256 (c’est l’opinion de Knorr qui pense qu’un de ses ouvrages a été composé après 1239) ?
Ce n’est pas la pierre tombale de Sacrobosco que l’on voit ici ( hélas ! ), même si celle-ci date du Moyen Age et est actuellement visible sur le mur du Musée de Cluny, à proximité de l’endroit où se trouvait celle de Sacrobosco.
En revanche, elle était encore visible en 1792 puisque Lalande écrit dans son Astronomie :
« Il fut enterré
dans le cloître des Mathurins, où l’on voit encore un astrolabe sur son tombeau
avec des vers latins. »
On ne sait pas trop de quelle sorte d’astrolabe il s’agissait. Sans doute une sphère armillaire puisque Riccioli (Almagestum novum 1651) parle d’une « sphère gravée » (sphaera insculpta). Vinet dans Sphaera Joannis de Sacro Bosco… cum annotationis et scholiis doctissimi viri Eliae Vineti… (Paris 1550) cite l’épitaphe qui figurait sur cette tombe :
«De Sacrobosco qui computista Joannes
Tempora discrevit, iacet hic tempore raptus.
Tempora qui sequeris, memor esto quod morieris.
Si miser est plora : miserans pro me precor ora. »
Si ce texte semble classique de ce type de littérature tombale, le début de la première phrase présente Sacrobosco comme un « computiste », c’est à dire expert dans le calcul du temps et du calendrier, qui fit ressortir les différents aspects du temps.
Saint Mathurin fut à l’origine un hôpital, confié en 1229 aux frères de la Sainte Trinité. Dans les années qui suivirent, sa chapelle devint en quelque sorte le siège de l’Université, qui, ne possédant pas de bâtiment propre, y tenait ses réunions. Sacrobosco devait donc être considérer comme un personnage très important pour y avoir été enterré, même si le monument a pu être construit quelques temps après sa mort.
Voici ce qu’en dit André Thevet (Histoire des plus illustres et scavants hommes de leurs siècles) :
« avec grands honneurs [il] fut enterré dans le Cloistre des Mathurins de Paris : maison qui autresfois appartenait à l’Université, pour ce que les assemblées publiques s’y font, & les processions tant des Recteurs que de l’Université, faut qu’elles sortent de ce Monastère. Quelques temps après les Recteurs, Procureurs & Doyens de cette Université firent de nouveau refaire son tombeau, sur la pierre duquel ils firent graver une sphère, avec cette inscription Hic conditus est Ioannes de Sacrobusto, pour l’honneur & le respect qu’ils portaient à cet excellent Astrologue. ».

Bien sûr, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement spectaculaire, mais c’est tout ce qui reste (du moins dans les parties extérieures visibles) du couvent des Mathurins, fondé en 1209, fermé en 1790 et détruit en 1855. Ce lieu (aujourd’hui rue de Cluny) fut le cœur de la toute jeune Université de Paris et abrita la sépulture de notre grand Sacrobosco… alors, en se motivant un peu, l’émotion gagne.
Il n’y a pas même une plaque signalant ces vestiges. Peut être que l’association des lointains admirateurs de Sacrobosco devrait faire quelque chose…
Sacrobosco et l’Université de Paris
Sacrobosco semble assez atypique à l’Université de Paris, où la philosophie et la théologie sont davantage à l’honneur, et certains livres d’Aristote officiellement interdits (jusqu’en 1255). Il semble faire preuve d’une certaine indépendance d’esprit, en particulier dans l’importance qu’il accorde aux mathématiques dans la compréhension de la nature. Ces idées plaident en faveur d’une formation de Sacrobosco en dehors de l’Université parisienne, sans doute à Oxford.
Comme professeur, le salaire de Sacrobosco était versé par l’Eglise, et son statut était celui d’un clerc tonsuré (maîtres et étudiants étaient tonsurés). Il a eu à enseigner les matières du quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie et musique), plutôt négligé à Paris, à de jeunes garçons (14 ou 15 ans la première année), à l’esprit vierge. Ceci a sans doute développé les qualités pédagogiques dont il a su faire preuve dans sa « Sphère ».
Sacrobosco apparaît comme un innovateur, différent de ses collègues aristotéliciens (lesquels sont pourtant à la pointe du modernisme philosophique à Paris) par sa conception « mathématique » de la science. Son Algorismus, inspiré d’une traduction d’Adélard de Bath ou du Liber abbaci de Léonard de Pise, fut largement adopté par l’Université et contribua à la diffusion des chiffres arabes et des méthodes algorithmiques.
Sacrobosco commence ainsi son Traité de la Sphère par deux définitions purement géométriques de la sphère (à la façon des Eléments d’Euclide). Il ne fait aucune allusion directe à Aristote et à son De Caelo, mais ne remet pas en question la division aristotélicienne en sublunaire et supralunaire.
Les œuvres de Jean de Sacrobosco
Compte tenu de la célébrité de Sacrobosco, on a tendance à lui attribuer davantage d’œuvres qu’il n’en a réellement écrites. Il y a cependant trois ou quatre ouvrage dont on peut garantir l’authenticité. Nous les décrivons rapidement ici, selon ce que l’on pense être l’ordre chronologique de leur rédaction.
Algorismus
Il s’agit d’un traité d’arithmétique élémentaire utilisant les « chiffres arabes » , d’environ 5 600 mots et qui connu un certain succès, contribuant à la diffusion de ces techniques de calcul en occident. La première édition imprimée en est faite à Strasbourg en 1488. Selon Pierre Duhem, l’Algorimus « est resté, pendant tout le Moyen Age , le plus usité des manuels d’Arithmétique ».
Tractatus de Quadrante
D’après Pederson, on est un peu moins certain de l’authenticité de ce livre (moins que les trois autres), mais on peut l’attribuer avec une forte probabilité à Sacrobosco. Il s’agit d’un traité d’environ 2 000 mots sur la construction et l’utilisation des quadrant de hauteur (formant un quart de cercle ). Sacrobosco y expose deux formes de quadrants. Le simple (« simplex ») valable pour une seule latitude et le « compositus », muni d’un curseur ajustable selon la latitude. Ce texte de Sacrobosco, sans doute inspiré par des sources arabes, est à l’origine de nombreux traités du Moyen-Age sur le « quadrans vetus ». Delambre a examiné ce texte dans son Histoire de l’astronomie du Moyen Age (1819).
D’après W. R. Knorr, le traité du Quadrant aurait été écrit après 1239, selon une citation des tables du Soleil d’Humeniz. Cela ferait de ce traité la dernière œuvre de Sacrobosco (et non une des premières comme supposé par Pederson) et repousserait la mort de Sacrobosco à 1256 (au lieu de 1236). Un autre argument, pour modifier l’ordre des traités présenté ici, est que La Sphère ne fait allusion qu’à l’astrolabe pour mesurer l’élévation du pôle, sans évoquer le quadrant, comme aurait pu le faire Sacrobosco s’il avait composé ce traité avant.
Tractatus de Sphaera
Le Traité de la Sphère fait environ 9 000 mots. Il comprend une préface et quatre chapitres et décrit le système de Ptolémée. On ne connaît pas la date exacte de sa composition mais il ne fait aucun doute qu’il a été écrit à Paris. Bartholomé de Parme affirme en 1297, dans son commentaire de La sphère, que « Jean de Sacrobosco dit dans son Traité de la Sphère, qu’il composa pendant qu’il vivait à l’Université de Paris… »
Les références littéraires (Ambrosius, Lucain, Ovide, Virgile, la Bible) mais surtout scientifiques (Alfraganus [Al-Farghani], Almeon [Al Ma’mun calife de Bagdad], Aristote, Eratosthène, Euclide, Ptolémée, Macrobe…) que l’on trouve dans La Sphère montrent que Sacrobosco avait déjà beaucoup lu sur le sujet au moment de sa rédaction. On situe celle-ci vers 1230-1231. Dans son traité, Sacrobosco suit une tradition d’exposé « narratif » de la théorie des planètes (dans la ligne d’Al-Farghani, Martianus Capella ou Macrobe) sans démonstration mathématique (comme Ptolémée ou Ibn Thabit). De plus, les nombreuses références historiques qui parsèment le livre montrent que son auteur est conscient de la valeur de l’histoire dans l’enseignement des sciences.
La Sphère de Sacrobosco a souvent été critiquée comme une simple compilation, sans nouveauté et sans trace d’aucune observation. Le jugement de Delambre, dans son Histoire de l’astronomie du Moyen-Age (1819), est sans appel (mais on a reproché à Delambre d’être davantage astronome qu’historien, et, de plus, notre opinion sur le Moyen-Age a depuis bien évoluée) :
« Le plus ancien
ouvrage d’Astronomie que l’Europe ait produit, ou qui nous soit parvenu, est la
Sphère de Sacrobosco, livre qui longtemps a été le seul classique, et qui n’en
est pas moins médiocre. L’étude de l’astronomie était presque entièrement tombée,
par la difficulté de se procurer et d’entendre les ouvrages des anciens
astronomes. Sacrobosco, pour ressusciter un peu cette étude, composa un abrégé
où il se contenta d’extraire ce qu’il y avait de notions plus élémentaires dans
les écrits de Ptolémée, d’Alfragan et d’Albategnius. Il n’y mit rien de lui-même ;
il n’avait jamais pratiqué l’Astronomie. »
Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un ouvrage pédagogique d’astronomie « élémentaire ». Sacrobosco faisait sans doute des observations (voir le traité, plus technique, du Compotus). De plus, à la structure traditionnelle tenue de Ptolémée, Sacrobosco ajoute certains concepts issus de l’astronomie nouvelle. Il décrit le phénomène de la précession (observé par Hipparque), ce que ne faisaient pas ses prédécesseurs des Ecoles, en ajoutant une 9ème sphère, vide d’étoile, impulsant à la 8ème sphère des étoiles fixes un mouvement vers l’Est de 1° en 100 ans.
J. S. Bailly, dans son Histoire de l’astronomie moderne (1785), expédie, lui aussi, Sacrobosco en quelques lignes (moins méchamment que Delambre) :
« Jean de Sacrobosco, Anglois, fit un abrége de l’Almageste & des Commentaires des Arabes, qui fut long-temps fameux sous le nom de Traité de la Sphère. C’étoit dans ce livre qu’on étudioit l’astronomie, toute la science y étoit alors renfermée. Il conserva sa réputation dans les tems plus éclairés, comme ouvrage élémentaire ; aujourd’hui il est oublié. »
Quant à Pierre Duhem dans Le système du monde, tome III, édition de 1958, il rejoint l’opinion de Delambre :
« les quatre
chapitres qui devaient assurer à leur auteur cette réputation étendue et
durable ne formaient qu’un petit traité bien humble, bien pauvre d’idées comme
de faits et pour tout dire, bien médiocre. »
Duhem reconnaît cependant que « Johannes de Sacro-Bosco eut le don de composer des traités élémentaires », ce qui peut se comprendre comme un compliment, et pas des moindres.
Vous vous forgerez votre propre opinion en consultant les pages de ce site où est reproduite l’édition de 1607. Les qualités pédagogiques de l’ouvrage ne sont pas un mirage, quant au charme des gravures sur bois (avec leurs petits bonhommes se baladant sur la Terre), il vous fera craquer…
Compotus
C’est le plus long (environ 19 000 mots) et le plus original des traités de Sacrobosco. D’après un passage, on en déduit qu’il a sans doute été écrit en 1232 ou 1235. Il s’agit certainement de son dernier écrit (si l’on situe sa mort en 1236). Il y traite du calendrier, du comput ecclésiastique et civil. Cet ouvrage était particulièrement utile dans le contexte théologique de l’Université de Paris, ce que l’on constate par la référence qui en était faite sur la pierre tombale. Dans le Compotus, Sacrobosco propose une réforme du calendrier, 350 ans avant la réforme grégorienne (mais il proposait d’enlever 1 jours tous les 288 ans au lieu de tous les 400 ans comme c’est le cas actuellement, utilisant une mauvaise durée de l’année solaire).
Conclusion
Certes les détails de la vie de ce grand maître du Moyen Age nous resterons sans doute à jamais inconnus. Reste l’essentiel.
Sacrobosco, par son traité sur la Sphère, a su rendre la science astronomique accessible à ses élèves, pour lesquels la lecture de l’Almageste de Ptolémée était hors de portée. Plus important encore, dans un contexte ou la modernité était Aristote, il fit à ses étudiants une autre présentation de la science, dans laquelle on cherche à penser « mathématiquement » les phénomènes observés. Bref, ce n’est pas par hasard que son traité fut un tel « best seller ».
> Retour vers la page
Sacrobosco