L'ASTROLABE
SUR CE
SITE : « l’astrolabe en
scène » lors du festival international Science on Stage 2007 : astrolabe_bienvenue.htm
(ce lien conduit à une nouvelle présentation de l’astrolabe, ses principes, son histoire,... réalisée en français
et en anglais lors de la participation à ce festival scientifique).
SUR CE
SITE : étude d’une reproduction
d’astrolabe persan : astrolabe safavide.htm .
SUR CE
SITE : al-Khwarizmi et l’astrolabe : Khwarizmi astrolabe.htm .
SUR CE
SITE : les astrolabes à Ispahan en 1673 par Jean Chardin : chardin.htm .
Instrument
phare de l'astronomie, avec la sphère armillaire, l'astrolabe en est la
projection stéréographique. Comme cette dernière, il est une représentation de
l'Univers, dans sa vision géocentrique, et permet de "prendre les
astres" (c'est l'étymologie grecque de son nom), pour donner l'heure,
s'orienter, calculer et prévoir des phénomènes astronomiques et par là même
dresser un horoscope. Pour ses multiples usages, il fut connu comme le "roi
des instruments mathématiques". C'est aussi celui dont la longévité
fut la plus grande, en usage depuis la fin de l'Antiquité, jusqu'au début des
temps modernes. Enfin, c'est sans doute l'instrument mathématique dont le
charme ésotérique est le plus immédiat. Voici la présentation qu'en fait Jean
Stöffler pour l'introduction de son Traité de la composition et fabrique
de l'Astrolabe, et de son usage :
"A tous les amateurs
des bonnes lettres, &
étudiants es
arts libéraux, Jean Stofler
présente Salut.
Encore que pour l'usage, et pratique des
Mathématiques, lecteurs débonnaires, plusieurs instruments, forts beaux et
dignes d'admiration, aient été inventés, déclarés, expliqués, et démontrés
entièrement, par plusieurs livres décrits par auteurs très excellents : si
est-ce que l'invention, et description, qui est faite du Planisphère, ou
Astrolabe, entre toutes est la plus belle, et laquelle on doit plus estimer."
[…] "d'autant que ceci servira d'un
vocabulaire à ceux, qui sont studieux en la discipline des Mathématiques, pour
raison de la noble et haute inquisition de ses innumérables commodités, et
usages."
[…] "vous souhaitant, bénins lecteurs,
en toute prospérité, santé entière. De Tubinge, l'an de Salut mil cinq cent
dix."
Principe et usages de l'astrolabe
Selon
Sévère Sabokt, évêque syriaque du VIIe siècle, et auteur de
l'un des plus anciens traités de l'astrolabe qui nous soit parvenu, "L'astrolabe
est instrument artificiel, composé, à l'aide duquel on détermine les étoiles,
les heures, les levers, les zones tropicales, en un mot, le double mouvement en
longitude et en latitude de la sphère céleste et les changements de climat[1]."
Pour
"prendre les étoiles", on utilise le dos de l'astrolabe que l'on
tient alors verticalement. Une tige, nommée alidade (al-idada =
la pièce forgée en arabe), ou dioptre en grec, et munie de deux
œilletons, les pinnules,
permet de viser un astre pour en déterminer la hauteur (angle mesurant son
altitude).
Cette
mesure étant faite, on prend, à plat, l'astrolabe côté face, pour obtenir, par
rotation des pièces, l'information souhaitée (l'heure par exemple). Le simple
mécanisme de l'instrument remplace tout calcul.

Cette partie de
l'instrument consiste en une projection stéréographique du système géocentrique
de l'Univers.
Les
astrolabes sphériques ont existé (on en voit un au musée d'Oxford).
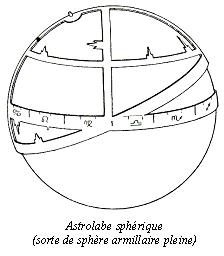
Cependant
tout l'intérêt de l'astrolabe planisphérique réside dans son faible
encombrement et sa facilité de construction.
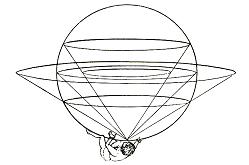
Imaginez
votre œil situé au pôle sud de la sphère céleste, la face de l'astrolabe correspond
à ce que vous voyez, projeté sur le plan de l'équateur céleste, et limité au
tropique du Capricorne.
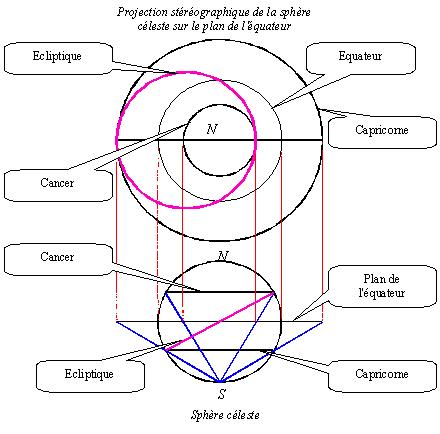
On effectue en fait
une double projection de la sphère céleste. Les parties mobiles de la sphère,
dont les étoiles et l'écliptique, donneront l'araignée, qui est la pièce ajourée au dessus de la face de
l'astrolabe. Ses pointes représentent les étoiles les plus brillantes. L'étoile
polaire (fixe dans le ciel) est au centre de l'araignée. En faisant pivoter
l'araignée autour de ce centre, on figure le mouvement apparent des étoiles
durant la nuit (la Terre est supposée fixe). Les repères fixes de la sphère,
comme l'horizon ou le méridien, donneront le tympan, situé au fond de l'appareil et correspondant aux
coordonnées locales d'observation. Dans l'hémisphère nord, la hauteur de
l'étoile polaire (centre de l'astrolabe) au-dessus de l'horizon correspond à la
latitude du lieu. Le tympan dépend donc de la latitude. De même que l'on règle
la sphère armillaire en latitude, on choisira donc le tympan adapté. Pour cette
raison, l'araignée est démontable.
L'astrolabe
a les mêmes usages que la sphère armillaire (en plus pratique) et d'autres
encore… Voici ce qu'en dit Jacques Focard dans sa Paraphrase de
l'astrolabe (édition de 1546) :
"Astrolabe comme il est dit, est sphère
solide mise en figure plate, par lequel on a connaissance des mouvements des
astres, et utilités procédant d'iceux. Or à vrai dire, les utilités que
d'icelui mettons par chapitres, sont petites, au regard de celles que met
Ptolémée en son Almageste. Et brièvement, les utilités qui viennent de lui,
ne se peuvent dire, tant sont grandes : par quoi me déporterai d'en écrire
plus avant."
Nous
n'entrerons donc pas dans les détails. Un auteur comme As-Suffi
(903-986) en donnera plus de mille utilisations !
La
première mesure possible, en tenant l'astrolabe verticalement, est, comme on
l'a vu, celle de l'angle de hauteur du Soleil, ou d'une étoile, par rapport à
l'horizon. Elle s'obtient par visée à l'aide de l'alidade à pinnules.
Avec
cette information, et connaissant la latitude (choix du tympan) et le jour, on
peut déterminer l'heure. Pour ce faire, prenant l'astrolabe à plat côté face,
on fait tourner l'araignée de façon à reproduire l'aspect du ciel à l'instant
de l'observation (hauteur de l'astre visé sur l'horizon). Il suffit alors
d'amener l'aiguille (ou index) en face de la date du jour, pour lire sur
l'heure le bord (limbe) de l'instrument.
On
peut résoudre les problèmes analogues à ceux envisagés avec la sphère : heure
et azimut du lever ou du coucher du Soleil, durée du jour, orientation selon
les points cardinaux…L'alidade à pinnules permettra de plus la résolution de
problèmes topographiques comme la mesure de distances inaccessibles, fondées
sur le théorème de Thalès.
Enfin,
on se doit de citer les usages astrologiques. Il s'agit d'une motivation
fondamentale dans le développement de l'astronomie. L'astrolabe, par exemple,
donne facilement l'ascendant astrologique, c'est à dire le signe du zodiaque se
levant à l'horizon à l'instant de la naissance de la personne. Les planètes,
parce qu'elles seraient errantes sur l'araignée des étoiles, n'y figurent pas,
mais, avec l'aide d'une table, l'astrologue peut les situer sur l'astrolabe et
en connaître ainsi les prétendues influences…
Histoire de l'astrolabe
Riche
de près de 20 siècles, l'histoire de l'astrolabe est un exemple remarquable des
échanges culturels des portes de l'Inde à celles de l'Atlantique.
L'astrolabe
est d'origine grecque. Son principe repose sur le procédé mathématique de la projection stéréographique de la sphère
(des étoiles) sur le plan (de l'équateur). Celui-ci est certainement dû à Apollonios de Perge, mathématicien du
IIIe siècle av. J.-C., mais c'est le grand astronome Hipparque qui, vers 150 av. J.-C., le
perfectionna et l'utilisa en astronomie. A Alexandrie vers 150 ap.
J.-C., Ptolémée donne, dans l'Almageste,
la description d'un "astrolabon organon" qui correspond, comme
nous l'avons vu, à la sphère armillaire. Dans un autre texte de Ptolémée,
le Planisphaerium, est décrit un planisphère rotatoire qui est une forme
primitive d'astrolabe, sans en posséder toutes les caractéristiques (pas
d'élément de visée). La première trace quasi certaine d'un traité de
l'astrolabe correspond à celui, au IVème siècle, de Théon d'Alexandrie.
L'ouvrage, qui ne nous est pas parvenu, est signalé dans une source arabe du IXème
siècle, qui en donne le plan, et par cette notice de la Souda,
dictionnaire byzantin du Xe siècle : "Théon [membre] du
Musée, égyptien, professeur de philosophie, contemporain de Pappus, lui aussi
alexandrin. Ils vivaient tous les deux à l'époque de Théodose l'Ancien [Théodose
Ier 379-395]. A écrit des ouvrages de mathématique et
d'arithmétique ; Sur les signes et l'observation des oiseaux ; Sur les cris des
corbeaux ; Sur le coucher du Chien ; Sur la crue du Nil ; Sur les tables
faciles de Ptolémée et un mémoire sur le petit astrolabe."
La
première description de l'astrolabe planisphérique qui nous soit parvenue, est
celle de Jean Philopon qui vécut à
Alexandrie vers 550 ap. J.-C.. Son Traité de l'astrolabe montre qu'au VIe
siècle l'instrument est techniquement fixé, et ses principaux usages, du moins
astronomiques, définis. Il ne s'agit pas d'un ouvrage théorique (aucune
justification mathématique) mais d'un ouvrage pratique assez court (15 brefs
chapitres). C'est avec émotion que l'on y voit décrits, au VIe
siècle, des gestes techniques qui seront pratiqués à l'identique jusqu'à une
époque récente. Voici les grandes lignes de ce traité :
JEAN LE GRAMMAIRIEN D'ALEXANDRIE
SUR L'USAGE ET LA
CONSTRUCTION DE L'ASTROLABE
ET SUR LES TRACES QU'IL
PRESENTE
1. Préambule.
La projection de la surface de la sphère sur
l'astrolabe, l'explication des tracés qu'il présente, l'utilisation de cet [instrument]
pour tous les divers [domaines] où il est utile, voilà ce que je vais, dans la
mesure de mes forces, exposer clairement ; sans doute ce [sujet] a-t-il déjà
été traité d'une manière satisfaisante par mon maître, le très philosophe
Ammonios, mais il réclame néanmoins davantage d'explication pour pouvoir être
saisi même par ceux qui n'ont pas reçu d'instruction dans ce domaine. Aussi
ai-je été engagé à faire ce travail par certains de mes amis. En premier lieu,
nous allons dire ce qu'est chacun des tracés que présente l'instrument.
[Suivent les chapitres suivants :]
2. Sur les tracés que présente la face sur
laquelle se trouve l'alidade[2]
et sur ce qu'indique chacun des tracés.
[Il s'agit d'un rapporteur gradué de 0° à
90°, gravé au dos de l'instrument]
3. Sur le tracé des tympans qui figurent les
climats : à quoi correspond chacun des tracés et combien de degrés vaut
l'obliquité du zodiaque.
[Chaque tympan est spécifique à une latitude,
désignée ici par le terme "climat".]
4. Sur les tracés de l'araignée.
5. Sur la visée diurne du soleil et comment
la pratiquer méthodiquement.
[En particulier, Philopon indique
qu'il s'agit d'une visée indirecte. On n'expose pas l'œil aux rayons du
soleil.]
Si donc, pendant le jour, nous voulons
déterminer à l'aide de l'instrument l'heure au soleil, nous le suspendons par
son anneau de tel sorte que le quart de cercle, qui a été divisé en quatre
vingt dix degrés, soit dirigé vers le soleil. […] il faut, comme je le disais,
faire tourner doucement en haut et en bas, l'alidade […] jusqu'à ce que,
l'alidade se trouvant alignée avec le soleil, le rayon du soleil, après être
passé par le trou de la pinnule de l'alidade tourné vers le soleil, en vienne à
passer aussi par le trou de l'autre pinnule, celle qui est de notre côté. […]
En tout cas, si tu approches ta main du trou qui est de notre côté, tu verras
la lumière tomber sur elle[3]. […]
6. Pourquoi les lignes horaires ont-elles été
tracées dans la partie [du tympan] qui correspond à l'hémisphère sous terre ?
Pour quelle raison commençons-nous de compter ces lignes à partir du couchant ?
Comment peut-on déterminer une fraction d'heure ?
[Il s'agit ici des lignes des heures dites
"inégales" : 12 heures de nuit, à partir du coucher du soleil jusqu'à
son lever, et 12 heures de jour, entre le lever et le coucher du soleil. Ces
"heures" ont donc une durée variable selon la saison. C'est pour
gagner en lisibilité que ces lignes horaires étaient gravées sous la ligne
d'horizon.]
7. Que les quatre centres à la fois son
donnés [sur l'instrument] : à savoir l'horoscope, le milieu du ciel et les deux
autres qui leur sont diamétralement opposés. […]
[Le mot horoscope désigne ici le signe du
zodiaque qui se lève, à l'horizon côté est, à l'instant de l'observation. Il
s'agit, dans le cas où l'observation est faite pour l'instant de naissance
d'une personne, de son ascendant astrologique.]
8. Sur la visée nocturne des étoiles fixes.
9. Comment savoir si le soleil (ou l'un
quelconque des fixes) a été observé avant son passage au méridien, sur le
méridien ou après son passage ; comment déterminer, pour chaque degré du
zodiaque, la plus grande hauteur atteinte.
[L'astrolabe permet d'obtenir sans calcul,
pour une latitude donnée, c'est à dire avec un tympan donné, la hauteur
maximale du soleil ou d'un astre au cours de l'année.]
10. Comment trouver combien de temps
équatoriaux chaque signe met à se lever ou à ce coucher.
[L'expression "temps équatoriaux"
correspond à nos heures "égales" : 24 heures de même durée entre deux
passages consécutifs du soleil au méridien.]
11. Comment trouver, de la même façon,
combien de temps équatoriaux vaut l'heure temporelle de chaque jour ou de
chaque nuit.
[Il s'agit là de convertir les heures
inégales, utilisées dans la vie courante, en heures égales, utilisées plutôt
par les astronomes.]
12. Comment trouver avec l'instrument la
longitude du soleil. Dans le même chapitre : comment déterminer la hauteur
maximum du soleil pour chaque jour.
[Il s'agit, à partir de la mesure de la
hauteur maximale du soleil (à midi), et connaissant la latitude, de trouver la
date du jour (ce qui correspond à la longitude du soleil, c'est à dire sa
position sur l'écliptique). Lisons Philopon.]
On peut aussi déterminer la longitude du
soleil sans calcul, en utilisant l'instrument de la façon suivante. Il faut
déterminer pour ce jour la plus grande hauteur au-dessus de l'horizon
qu'atteint le soleil. Ce que nous déterminerons en visant le soleil vers midi.
Il est évident qu'il faut le viser à plusieurs reprises, jusqu'à ce que [sa
hauteur] n'augmente plus mais que, le maximum ayant été atteint, elle commence
à nouveau à diminuer et que le soleil se rapproche de l'horizon. […] ensuite,
ayant placé l'araignée elle-même sur le climat où nous nous trouvons pour
observer [c'est
à dire sur le tympan correspondant à notre latitude] et ayant amené sur le
méridien chacun des degrés du quart de cercle que parcourt alors le soleil
[c'est à dire que l'on fait tourner la portion du cercle écliptique de
l'araignée correspondant à la saison en cours], nous chercherons lequel
parmi ces degrés, parvenu au méridien, s'élève d'autant de parallèles qu'on en
a trouvé, ce jour-là, le soleil élevé, et nous affirmerons que c'est ce degré
là qu'occupe à ce moment le soleil[4].
Cette méthode s'applique à condition que le soleil ne soit pas au voisinage des
solstices […].
13. Parmi les degrés du zodiaque, quels sont
ceux qui sont sous le même parallèle et qui s'élèvent à la même hauteur ;
comment découvrir dans quel quart de cercle du zodiaque se trouve le soleil,
lorsqu'il est voisinage des points solsticiaux.
14. Comment trouverons-nous la longitude de
chacune des planètes ?
15. Comment trouver de combien chaque degré
du zodiaque s'écarte par rapport à l'équateur soit vers le nord soit vers le
sud ; de même pour le soleil, la lune ou n'importe laquelle des planètes.

L'astrolabe
fut introduit dans le monde islamique au VIIIe siècle, à travers les
traductions des textes grecs. Muhammad al-Fazari est considéré comme le
premier à avoir confectionné un astrolabe. Il écrivit un ouvrage sur la sphère
armillaire et un autre sur l'utilisation de l'astrolabe. Cet instrument connut
un très grand succès dès le IXe siècle, où l'on fabriquait déjà de
véritables chefs-d'œuvre. Le monde musulman se distingue en effet alors des
autres civilisations par ses besoins d'une mesure précise du temps et des
phénomènes astronomiques, l'astrolabe permettant, en particulier, de déterminer
les heures des prières. Les Arabes en perfectionnèrent le principe pour
s'orienter dans le désert ou trouver la direction de La Mecque. Le dos
de l'instrument, laissé presque libre dans le traité de Philopon, sera
complété par des tables ou des abaques (pour les calculs trigonométriques ou
calendaires) et par un "carré des ombres", invention attribuée au
grand mathématicien du IXe siècle, Al-Khwarizmi, permettant
une utilisation de l'astrolabe à des fins topographiques (mesures de distances
inaccessibles…).
Enfin,
l'astrologie fut également une des principales utilisations de l'astrolabe et
une des raisons de son développement, comme du développement de l'astronomie.
Cette dernière va profiter, selon Ahmed Djebbar, "de l'engouement
des hommes de pouvoir pour l'astrologie afin de bénéficier de leur aide
financière (pour la construction de grands instruments astronomiques ou
d'observatoires) ou bien pour solliciter leur protection contre les courants
conservateurs hostiles à l'astronomie et à la philosophie". On attribue au
célèbre astrologue Masha'allah (mort en 815) un livre sur les procédés
de construction et d'utilisation de l'astrolabe, traduit en latin par Jean
de Séville au XIIe siècle. A la différence du traité de Philopon,
ce traité décrit non seulement l'utilisation de l'astrolabe, mais aussi son
tracé géométrique théorique, ce qui en fait le premier ouvrage complet connu
sur le sujet.
Aux
Xe et XIe siècles, l'Espagne musulmane fut un
important foyer d'études astronomiques et de réalisations d'astrolabes, puis le
Maroc et en particulier Marrakech et Fès aux XIIe
et XIIIe siècles. Au XIe siècle, le tolèdan az-Zarqali
(connu également sous le nom d'Arzachel) réalise le premier astrolabe
"universel", dont le tympan ne dépend pas de la latitude. Celui-ci
est obtenu par projection stéréographique de pôle le point g sur le plan
du colure des solstices (c'est à dire le cercle mené par les pôles et par les
points de l'écliptique correspondant aux solstices). De son traité sur la Safiha
az-Zarqaliyya (le terme Safiha, en latin Saphaea, désigne le
tympan de l'astrolabe), on connaît plusieurs traductions, dont une version
hébraïque par Don Abraham et une version espagnole par Ferrando.
Cet astrolabe sera "retrouvé" cinq siècles plus tard par Gemma
Frisius sous le nom d'Astrolabe catholique.
Les
astrolabes perses ou indiens deviendront par la suite de véritables œuvres
d'art, réputés pour leur décoration raffinée.
Le
fascinant pouvoir de connaissance, que semble offrir l'astrolabe, explique que
dès le Xe siècle, percer ses mystères était un enjeu important pour
les occidentaux, au contact en Espagne avec le savoir arabe. C'est ce
qui poussa Gerbert d'Aurillac (930-1003), le futur pape Sylvestre II,
à se rendre dans les couvents de Catalogne pour consulter les "Astrolabii
Sententiae", premier texte latin décrivant l'astrolabe. Si son
principe fut ainsi connu dès la fin du Xe siècle, son utilisation ne
fut importante qu'à partir du XIIIe siècle. Sur les premiers modèles
d'astrolabe importés d'Espagne, des mots latins furent gravés à côté des
originaux arabes. C'est ainsi que nombre d'étoiles portent encore, en français,
leur nom d'origine arabe (Altaïr, Vega, Deneb) et que l'objet astrolabe, comme
les traités décrivant son usage, constituèrent un vecteur de transmission de la
terminologie arabe du Ciel et des chiffres arabes (avec les tables
astronomiques).
L'astrolabe
connut son pic de popularité à la fin du Moyen Age et à la Renaissance. Il
était utilisé dans l'université médiévale pour l'enseignement de l'astronomie.
Le
XVIe siècle voit aussi la vogue des horloges astrolabiques dont le
mécanisme entraîne la rotation de l'araignée, montrant ainsi l'aspect du ciel.
Face
à leurs nouveaux besoins de navigation en haute mer, les Portugais, sous
l'impulsion de Jean II, développèrent
, à la fin du XVe siècle, la navigation astronomique, avec en
particulier la mesure de la hauteur d'un astre à l'astrolabe (navigation
"hauturière"). On fabriqua des astrolabes spécifiques aux besoins de
la navigation, plus simples et plus lourds, pour résister aux vents et aux
mouvements du bateau, et qui se fixaient au grand mât.
Aux
XVIe et XVIIe siècles, les horloges pouvaient avancer ou
retarder d'un quart d'heure par jour. On utilisait alors, pour les régler, soit
un cadran solaire, soit un astrolabe. Les progrès réalisés dans la construction
des horloges ont été l'une des causes du déclin de l'astrolabe au XVIIIe
siècle, dans le monde occidental. L'autre cause est l'introduction de la visée
optique. Après que Galilée le premier, a pointé une lunette vers le ciel
("Le Messager des étoiles" – 1610), la visée optique
s'imposera. Pour adapter les lunettes, on dut décomposer les anciens
instruments, les spécialiser. Ce fut la fin de l'astrolabe. Dans le domaine de
la navigation, l'octant, puis le sextant, le remplacèrent également à cette
époque.
L'astrolabe
était cependant toujours utilisé au début du XXe siècle au Maroc
(en particulier à la mosquée Qarawiyine de Fès) pour déterminer
le début du ramadan, et ses vertus pédagogiques sont, comme nous le verrons,
toujours intactes !
Astrolabes visibles à Ecouen : ecouen.htm